Monde ouvrier et pacifisme autour de la Grande Guerre
La nécessité s’est cependant doublé, pour un certain nombre de travailleurs, d’une contestation, voire d’une hostilité, vis-à-vis de cette industrie de guerre. Le mouvement ouvrier, avec ses expressions internationalistes du XIXe siècle – Internationales ouvrière, anarchiste et socialiste –, a maintenu au XXe siècle un crédo pacifiste, parfois antimilitariste [1]. La proximité entre socialisme et syndicalisme facilite cette diffusion. De nombreux syndicats affiliés à la CGT n’hésitent pas, avant 1914, à dénoncer les périls qui menacent les peuples européens. Entre seconde Crise du Maroc et Guerres balkaniques, les nations du Vieux Continent semblent sur le point de plonger dans un gigantesque brasier.
Le Congrès des syndicats français contre la guerre des 24 et 25 novembre 1912 invite ainsi, dans l’une de ces décisions, les travailleurs du pays à chômer le 16 décembre suivant. Le syndicat des ouvriers mouleurs de Saint-Étienne met en application cet appel. Du point de vue des employeurs travaillant pour les armées, cette position ne passe pas. Aux usines de la Chaléassière, la direction organise la fermeture de l’atelier [2]. Ce lock-out permet de congédier les ouvriers les plus engagés. Les autres sont repris quelques jours plus tard, aux conditions imposées par l’entreprise.
La menace antimilitariste est anticipée par l’armée française. Instauré par la loi Boulanger de 1886 afin de recenser les individus suspects d’espionnage, le carnet B devient progressivement un instrument chargé de lister l’ensemble des individus pouvant, par hostilité à l’armée ou à la patrie, entreprendre des actes de sabotage. Syndicalistes révolutionnaires, socialistes et anarchistes sont concernés par ce travail administratif. Cependant, lorsque la guerre devient inéluctable, le gouvernement fait le choix de ne pas mettre en application les arrestations préventives envisagées. La mobilisation est alors relativement consensuelle, caractérisée par une certaine résignation. Seule une poignée de militants anarchistes tente d’échapper, pendant quelques jours, à l’appel des drapeaux, en se cachant dans le massif du Pilat [3].
Aux heures les plus tragiques de la Grande Guerre, la tendance minoritaire de la CGT, opposée à l’Union sacrée, continue de porter une volonté de paix – au risque de la paix blanche, c’est-à-dire sans modification de frontières. D’importantes menaces judiciaires pèsent pourtant sur les militants, surtout pour les soldats affectés dans les usines de guerre. Les grèves de 1917 et du printemps 1918, animées notamment par le militant Clovis Andrieu, revendiquent ouvertement la fin du conflit [4]. Les révolutions russes et le traité de Brest-Litovsk (3 mars 1918) crédibilisent un tel horizon.
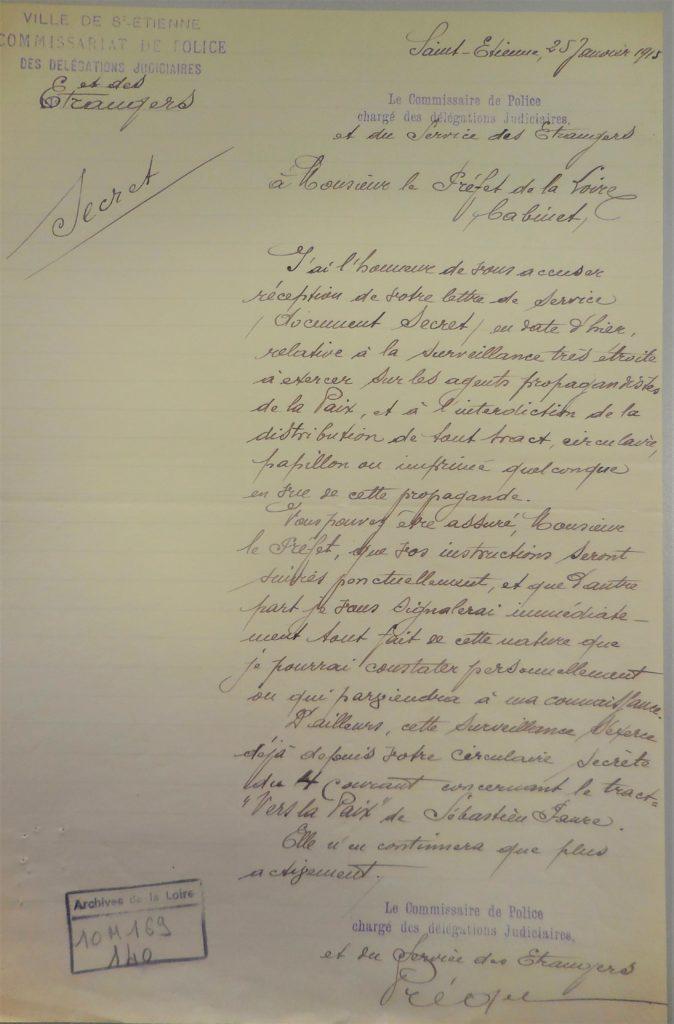
Le mouvement communiste, né au cœur du conflit, reprend l’antienne des militants socialistes et anarchistes des décennies précédentes. Ce point de vue s’inscrit, sans toujours se confondre, avec le discours des associations d’anciens combattants, toutes aussi vigoureuses dans leur revendication du « plus jamais la guerre » après « la der des ders » [5]. Un exemple est donné par l’ARAC, Association républicaine des anciens combattants, fondée en 1917. Cette organisation n’a cependant pas de rapport immédiat avec le mouvement ouvrier, malgré la politisation ultérieure de l’un de ses fondateurs, Henri Barbusse, adhérent du Parti communiste français à partir de 1923. L’écrivain est également à l’origine de la fondation, en 1933, du Mouvement Amsterdam-Pleyel, mis en place face à la montée du péril fasciste. La proximité de ces associations avec d’autres organisations du « conglomérat communiste », notamment la CGTU, permet toutefois de rapprocher ces engagements militants du monde ouvrier proprement dit [6].
Après 1945, un pacifisme ouvrier sous influence communiste
Après la Libération, la sidération née des explosions atomiques de Hiroshima et Nagasaki entretient le sentiment pacifiste. La nébuleuse d’organisations proches du PCF poursuit le travail militant entamé au cours de l’entre-deux-guerres. La Guerre froide naissante renforce, à partir de 1947, une telle orientation. Elle justifie notamment de nombreuses opérations antimilitaristes, motivées par l’internationalisme et la lutte anticoloniale. La guerre d’Indochine sert de contexte à ces revendications. Un important mouvement de contestation, parti des dockers de Marseille en novembre 1949, s’étend dans d’autres centres industriels français – la grève atteint les mineurs et les cheminots de Saint-Étienne en février 1950.

- AM Saint-Étienne, 5 FI 10636, Grève des mineurs et des cheminots ou manifestation pour la paix, février 1950 : Manifestants et forces de l’ordre avenue de la Libération. Cliché de Léon Leponce.
L’un des épisodes de cette campagne est connu sous le nom d’« affaire de Roanne », parfois baptisée « affaire du train » [7]. Le 23 mars 1950, à l’appel d’affiches placardées par la CGT, et d’un article du quotidien communiste Le Patriote de Saint-Étienne, une manifestation est organisée contre le départ d’un train chargé de cinq automitrailleuses, produites à l’Arsenal de Roanne et destinées, via le camp militaire de Coëtquidan, à être expédiées en Indochine. Les militants présents, principalement membres de la CGT, du PCF, de l’Union des femmes françaises (UFF) ou de l’Union des jeunes filles de France, se placent en nombre sur les rails, afin d’interrompre le convoi. À l’issue de l’assaut des forces de l’ordre, de nombreux manifestants sont arrêtés et emprisonnés au fort Montluc.

Parmi les dix-huit inculpés poursuivis par le tribunal militaire de Lyon, à partir du 22 août 1950, se trouvent le secrétaire de la Bourse du travail de Roanne Pierre Goutorbe [8], la secrétaire locale de l’UFF Jeanne – dite Jeannette – Pitaval [9], le journaliste du Patriote de Saint-Étienne Lucien Benoît [10] ou l’instituteur François Petit [11]. Malgré les lourdes charges pesant sur les inculpés – tentative d’entrave violente à la circulation du matériel destiné à la Défense nationale, plus provocation à ladite tentative d’entrave –, les « 18 de Roanne » sont finalement acquittés le 26 août. Cet événement s’inscrit dans un calendrier particulièrement agité, marqué par l’écho de l’appel de Stockholm, pétition lancée par le Conseil mondial de la paix, le 19 mars 1950, contre l’usage de l’arme atomique. D’autres manifestations du même type surviennent ensuite à travers le pays : le 11 mai à Saint-Brieuc, à Cannes en octobre 1950, à Nantes en mars 1951, etc.
Ces militants chevronnés s’impliquent ainsi dans des actions potentiellement violentes. La plupart occupent des responsabilités locales au sein de la nébuleuse communiste. Ces engagements réalisés au nom du pacifisme contestent ouvertement la politique gouvernementale, anticipant – ou même recherchant – la répression militaire ou judiciaire de la part des autorités. Cette prise de risque est même légitimée, puisqu’elle s’inscrit dans la carrière militante de ces personnalités, à l’image des responsables syndicaux et politiques des années 1920 et 1930, dont la condamnation judiciaire était une condition privilégiée de leur ascension hiérarchique.
La dimension conflictuelle de la revendication pacifiste au sein du mouvement ouvrier n’est cependant pas aussi systématique. L’hostilité que génère la course aux armements dans une large frange de l’opinion française, facilite par exemple la liaison entre militants communistes et militants chrétiens [12]. Cette proximité trouve un terrain d’expression privilégié au sein du Mouvement de la Paix, dont la fondation au niveau international, à partir de 1948, s’inscrit dans la prolongation directe du Kominform [13]. L’influence communiste au sein de la CGT facilite alors les passerelles entre le mouvement syndical et le reste du « conglomérat ».

Les conditions sont réunies, à nouveau, pour que les travailleurs chargés de fabrications militaires puissent exprimer un cas de conscience. Le texte suivant, paru en février 1952, illustre bien cette brèche fragile et incertaine, entre opinion et nécessité. Maurice Combe, présenté comme « ouvrier chrétien » plutôt que comme prêtre-ouvrier [14], militant CGT, assume publiquement la lecture d’un rapport produit dans le cadre des Assises départementales du Mouvement de la Paix, devant les membres du Comité de la Paix des usines de la SFAC (Société des forges et ateliers du Creusot, groupe Schneider), à la Chaléassière [15]. Le Patriote, quotidien communiste de Saint-Étienne, se fait l’écho d’une revendication qui s’inscrit parfaitement dans l’agenda du parti et du « conglomérat ».
























Compléments d'info à l'article